
Une découverte en forme de légende
Comme beaucoup de grandes découvertes, celle du bleu égyptien s’est faite par hasard.
Imaginons la scène : un bateau phénicien, transportant du natron, fait route vers l’Égypte. Comme il est de coutume à cette époque, on navigue en vue des côtes.
Quelqu’un va avoir l’idée brillante d’aller chercher quelques blocs de natron au fond de la cale pour les remplacer. Au contact du feu, le natron (fondant sodique) va agir sur le sable (silicium) pour produire une étrange substance vitreuse, au grand étonnement des marins.


Peut-être ne s’est-elle pas déroulée tout à fait ainsi. Mais il est malgré tout sûr que c’est bien par le mélange fortuit de sable contenant des composés de cuivre avec du natron, le tout chauffé ensemble, qu’a été inventée cette pâte vitrifiée colorée.
Reproduite et améliorée, la formule permettra aux Assyriens mais surtout aux Égyptiens, de produire une infinité d’objets, aux coloris allant du bleu vif au vert tendre.
Un large éventail d’objets …


Une multiplicité qui s’explique par le fait que cette couleur entre bleue et vert était très prisée des égyptiens de l’époque car elle symbolisait la vie.
Par ailleurs, dans sa tonalité la plus bleue, elle imitait le lapis lazuli, pierre rare et chère provenant d’Afghanistan.


et d’aspects,
La qualité de ces objets est très variable.
Certaines pièces présentent des défauts de cuisson avec une couleur mal répartie.
Des imperfections qui font ressortir la difficile maîtrise que représentait le processus de fabrication, avec les fours de l’époque.
Maintenir la cuisson en continu à haute température sur 24 à 48 heures représentait alors une véritable prouesse. Le bois étant rare dans la vallée du Nil, les artisans devaient utiliser des cannes de roseaux pour activer leurs fours.

Produites en grand nombre, certaines pièces telles que les amulettes ou les ousheptis ne faisaient pas toujours l’objet d’une finition très poussée.
Des disparités d’aspect qui rendent d’autant plus exceptionnelle, par comparaison, la qualité des bleus les plus réussis.
pour des applications très variées
Sur d’autres, plus sophistiqués, des dessins et hiéroglyphes apparaissent sur la surface. Ce qui implique une double cuisson.
Les artisans avaient en effet remarqué qu’en broyant la matière vitrifiée, on pouvait obtenir une poudre qui pouvait être réappliquée sur l’objet puis recuite, pour un ré-émaillage plus marqué.

Bijoux et autres objets précieux
Broyée, fondue, transformée en pâte de verre, cette poudre n’a pas servi qu’à émailler des objets. Associée à l’or, aux pierres précieuses et semi-précieuses, elle a permis la création d’extraordinaires bijoux et objets…
à suivre …

_______________
Documentation :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu_égyptien
https://www.pourlascience.fr/sd/archeologie/l-epopee-du-bleu-egyptien-7451.php










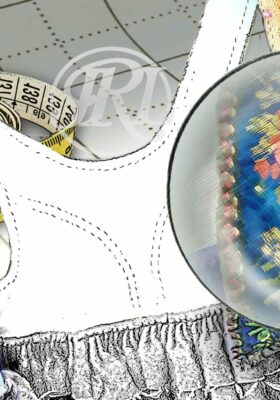

Qu'en pensez-vous ?